
La recherche de provenance, impensé du monde de l’art
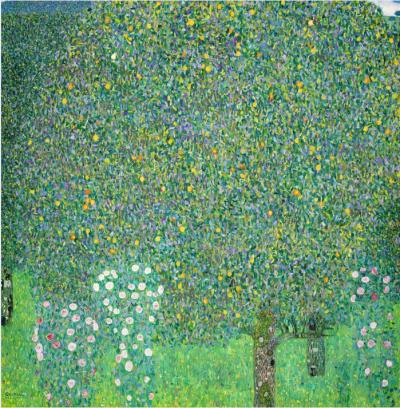
Le marché de l’art a beau nager dans l’euphorie, il est tenaillé par une angoisse sourde : l’anxiété de la provenance. De récents scandales ont remis cette préoccupation de longue date à l’ordre du jour.
Longtemps, à l’instar de l’histoire de l’art, le commerce des biens culturels a cultivé le sentiment de l’insignifiance de la provenance. Après tout, la majorité des œuvres détenues paisiblement par les familles sont des sans-papiers, sans que l’on puisse pour autant les soupçonner de fraude. De cette coutume découle une présomption de propriété, que résume la maxime de bon sens : « En fait de meubles, la possession vaut titre » – article 2276 du Code civil, alinéa 1. Ancrée dans le droit romain, elle est fixée dans le Code civil des Français de 1804. Elle se retrouve peu après sous la plume de Balzac dans la bouche de l’usurier Gobseck, lequel accepte de gager les diamants offerts par la comtesse, alors même qu’il se doute qu’elle n’aurait pas la légitimité d’en disposer, en profitant pour les soutirer à vil prix. L’épisode est significatif : cette protection peut être détournée par l’avidité d’un marchand, pressé de conclure une affaire louche. C’est la même suspicion qui pèse aujourd’hui sur le négoce, dont il peine à se débarrasser.
Ce droit de propriété n’est cependant pas sans limite. Le Code Napoléon stipulait : « Celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve. » Et, comme déjà le marché de l’art n’était pas sans ombre, l’article suivant prévoyait le cas où « le possesseur actuel de la chose volée, ou perdue, l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles ». Dans ce cas, « le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté ».
Durant des siècles, cette dérogation a obéi à des critères variables, selon les périodes et les provinces. Dans son Droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en principes, dont la première édition date de 1741, Me François Bourjon considérait que « la simple possession produit tout l’effet d’un titre parfait », en recommandant de « suivre la jurisprudence du Châtelet », pour laquelle, cette détention, « ne fût-elle que d’un jour, vaut titre de propriété ». Il lui trouvait cependant « une seule exception » : « La chose furtive peut être revendiquée partout où on la trouve. » Furtivae quoque res, et quae vi possessae sunt, nec si praedicto longo tempore bona fide possessae fuerint, usucapi possunt. « Les biens volés ou acquis par la force ne peuvent être acquis par l’usage, même détenus de bonne foi » – même si les principes justiniens, qui essaimèrent en Europe au Moyen Âge, n’excluaient pas certaines exemptions. La Convention Unidroit (1995) ne dit pas autre chose : « Le possesseur d’un bien culturel volé doit le restituer. » Non ratifiée par la France, elle est honnie des marchands d’art, dénonçant l’insécurité qu’elle imposerait à leurs transactions et les risques d’injustice pour les possesseurs de bonne foi.
Depuis un siècle, des affaires en série
Le débat qui revient aujourd’hui avec vigueur ne date pas d’hier. La première brèche qui a sauté portait sur les biens issus de la spoliation nazie. Il faudrait rappeler que, dans la seconde moitié du XXe siècle, un tableau de la collection Schloss, pillée sous l’Occupation, est passé quatre fois aux enchères, à Londres et New York, de 1967 à 1989, sans que personne s’en émeuve et sans aucun contact entrepris avec la famille. Dans sa dernière notice, Sotheby’s a même indiqué « Volé par les nazis », mention que Christie’s a soigneusement effacée dans la vente suivante, si bien qu’on ne sait à qui revient la palme du cynisme. Depuis, l’état d’esprit a bien changé. Mais, encore aujourd’hui, en France, en dépit de timides progrès, les musées répugnent à passer au crible leurs collections et consentir à des restitutions aux familles des victimes de la Shoah, si bien qu’elles sont régulièrement contraintes à faire appel aux tribunaux pour obtenir réparation
Le redoublement de la lutte contre le trafic archéologique, à la suite des exactions de Daesh dans les années 2010, a relancé cette dispute. Dans la mesure où il est très difficile pour les pays victimes de justifier la réalité et la date du pillage ou de la sortie en contrebande, la tentation est grande de renverser la charge de la preuve, en exigeant des marchands et des collectionneurs qu’ils démontrent la sortie légale du territoire d’origine. À New York, si cette preuve manque, l’objet peut être saisi et rendu au pays dont il provient, l’Égypte, le Pérou, le Cambodge ou l’Italie. Le chef de l’unité du trafic d’antiquités au parquet de New York, Matthew Bogdanos, l’explique en termes abrupts : « En Europe, vous pouvez acquérir de bonne foi une œuvre pillée ou volée et prétendre à un titre de propriété. Aux États-Unis, quand un bien a été volé, il reste toujours volé ! »
L’Union européenne, elle, est en train d’imposer un système d’importation des biens culturels qui promet d’être un casse-tête pour ceux ne pouvant documenter l’origine, même lointaine, de leur propriété.
La fabrication de la provenance
Méprisée par l’histoire de l’art, négligée par le marché, la recherche de provenance a été l’impensé du monde de l’art, conduisant à un retour brutal à la réalité des crimes et des fraudes. J’en voudrais pour preuve cette observation stupéfiante confiée par le conservateur de la splendide collection du prince de Liechtenstein, qui ne s’est jamais enquis de la provenance falsifiée de la Vénus au voile, achetée quand même pour 7 millions d’euros comme un Cranach : « Mais cela, c’est le travail de la police ! » Dans l’affaire Ruffini – du nom du principal suspect, désormais assigné à résidence à Paris et qui clame son innocence –, rendue publique en 2016, aucun des chefs-d’œuvre attribués à de grands maîtres et vendus pour des millions ne détenait d’historique ; dans certains cas, ils arboraient même différentes provenances récentes. Or, ces caractéristiques extrêmement troublantes n’ont éveillé aucun soupçon chez les experts, galeristes et conservateurs d’Europe ou d’Amérique qui ont authentifié ces peintures, dont un portrait donné à Frans Hals reconnu comme un « trésor national » par le Louvre – avant de faire silence quand les laboratoires ont décrété qu’il s’agissait de faux modernes.
Une des difficultés pour les victimes est l’invention par les trafiquants d’historiques, faux documents à l’appui, qui peuvent se montrer très difficiles à déchiffrer. Un maître en la matière est Wolfgang Beltracchi, démasqué en 2010, qui avait pris grand soin de fabriquer ses pastiches de l’art moderne à partir de catalogues des années 1920. Avec son épouse, il avait mis en scène des photographies sépia d’intérieurs d’appartement prétendument de l’époque, les fameuses toiles accrochées aux murs, tout en collant de fausses étiquettes de galeries au dos.
Le scandale de trop
Le même soupçon d’une fabrique de provenance se retrouve dans l’autre scandale majeur d’un trafic supposé d’antiquités égyptiennes, visé par une enquête dont les ramifications s’étendent de New York à Abou Dhabi, Dubaï, Hambourg, Paris et Londres. En 2020, l’inculpation du principal expert de la place parisienne pour escroquerie en bande organisée a été suivie de la mise en cause d’une prestigieuse maison de ventes et de conservateurs du Louvre, foudroyant le monde des musées. Désormais contestée pour partialité, cette enquête, dont le ton inquisitorial a été relayé par un étalage en public du dossier d’instruction, mêlant vraies et fausses informations, a bien abîmé l’aura de la France dans le domaine culturel.
Ce constat a conduit la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, à confier une mission de réflexion à trois « sages », sur les moyens de renforcer la sécurité des acquisitions des musées. En arrière-fond, tout le monde pensait à l’achat par le château de Versailles de faux sièges « de Marie Antoinette », objets d’une instruction judiciaire qui n’a pas avancé d’un pas depuis la mise un examen d’un expert réputé, d’un ébéniste de talent et d’un antiquaire célèbre, il y a près de sept ans. Dans son rapport, la mission ne manque pas du reste de déplorer la longueur exorbitante des procédures judiciaires, au civil et encore davantage au pénal, confortant « les professionnels indélicats, minoritaires mais actifs, dans leurs dérives ».
Cette mission avait été confiée à Christian Giacomotto, membre du Conseil artistique des musées, président du comité d’audit de l’agence France Muséums et ancien président du Conseil des ventes, Marie-Christine Labourdette, ancienne directrice des Musées de France, et Arnaud Oseredczuk, du comité de déontologie au ministère. La ministre a fait preuve d’une certaine bravoure en rendant public, le 21 novembre 2022, ce document assez critique, faisant savoir qu’elle encouragerait la mise en œuvre des recommandations. En substance, il est proposé de renforcer la formation et les moyens de recherche de provenance des musées, ainsi que les contrôles des négociants, en particulier des experts.
Aucun calendrier n’a cependant été délivré, si bien qu’une sage prudence s’impose quant au sort réservé à ces préconisations, d’autant que plusieurs relèvent de pourparlers interministériels. Certaines, comme le refus pour les musées d’acheter des œuvres passées en vente publique depuis moins de cinq ans, ou un encadrement des délivrances de « passeport », n’ont pas manqué de susciter de vives oppositions des marchands. Une nouvelle étape, dans la foulée d’un nouveau rapport de Jean-Luc Martinez, ambassadeur de France chargé de la coopération culturelle, doit être la présentation au parlement des projets de loi encadrant les restitutions. Le président du Conseil des ventes, Henri Paul, a aussi souhaité l’instauration d’une base de données des biens culturels interconnectée « comportant des œuvres des collections publiques, des œuvres soumises aux certificats d'exportation, des documents du livre de police informatisé des marchands et des maisons de vente, des fichiers des services de police et des œuvres volées ou pillées », pour encourager les professionnels dans cette voie, toujours éprouvante, de la rédemption.
---
Par : Vincent Noce - Focus extrait du Bilan des enchères 2022 édité par Beaux-arts et le CVV.
Voir la page dédiée du colloque "La recherche de provenance, nouvelle exigence du monde de l'art" de novembre 2022


